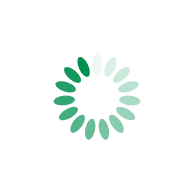Conversation croisée entre Claude Gruffat, eurodéputé écologiste et Alexis Nollet de l’écosystème Ulterïa (200 salarié·e·s, 25 millions € de chiffre d’affaire) qui a décidé de graver dans le marbre son modèle social et écologique pour le protéger en cas de changement de propriétaire.
Avec son associé Sébastien Becker, Alexis Nollet est le cofondateur d’Ulterïa, un groupe industriel de 9 entreprises, originaire de Bourgogne. Une aventure débutée en 2006 avec le rachat d’une menuiserie. Aujourd’hui, la société compte 200 personnes et fait 25 millions € de chiffre d’affaire. Son cœur de métier est l’agencement écologique et le zéro déchet. Au contact du mouvement bio dont sont issus leurs clients, les dirigeants d’Ulterïa se sont posés depuis le début la question de la transition écologique et climatique et de ses conséquences sur les entreprises, notamment sur leur territoire d’implantation.
Pourquoi la question de la transmission d’entreprise est-elle stratégique pour la transition écologique ?
Alexis Nollet : La question n’est pas tant la transmission mais en quoi l’entreprise est un pilier de la transition écologique. Quand on compte le nombre d’heures qu’on passe au travail dans la vie, on voit bien que c’est une question centrale. Les études, notamment de l’Ademe, montrent que modifier les comportements individuels (consommation de vrac, usage plus sobre de l’eau, déplacements décarbonés, etc.) ne résoudrait que 25% du problème. Il faut le faire évidemment, mais ce n’est pas suffisant. L’enjeu majeur est au niveau du système économique où une prise de conscience majeure est nécessaire. C’est le propos de démarches comme la convention des entreprises pour le climat, le mouvement IMPACT France, et d’autres qui veulent emmener les entrepreneurs·euses dans la transition écologique.
Pour répondre au défi écologique, il faut arrêter l’approche philanthropique et proposer des changements systémiques. Dans cette optique, la transmission est en effet un sujet majeur. En France, les actionnaires, qui sont propriétaires des entreprises, font ce qu’ils veulent car la mission de l’entreprise n’est généralement pas un point statutaire (hormis pour les entreprises à mission, un statut introduit récemment par la loi Pacte). Dans les statuts on trouve la gouvernance et l’organisation mais pas la raison d’être de l’entreprise, ni ses missions ni ses valeurs. Ainsi, au moment de la transmission, les belles valeurs d’une entreprise peuvent être saccagées si on ne la réoriente que sur son aspect économique et de machine à profit.
Claude Gruffat : Mais vous, qu’est-ce qui vous a amené à interroger cette question de la transmission ?
Alexis Nollet : En 2015 on a eu une proposition de rachat par un grand groupe américain alors qu’on avait déjà bien avancé dans la construction d’un modèle bénéfique à notre équipe, à notre écosystème et adapté aux enjeux de la transition. On s’est donc vu offrir la possibilité, avec Sébastien, d’encaisser un gros chèque mais à condition de laisser les coudées franches à une entreprise américaine. La reprise se serait alors faite sans considération pour les valeurs et les engagements de la boite, hormis une possible valorisation par le greenwashing. L’autre option était de ne pas vendre mais de faire en sorte que ce ne soit plus possible statutairement que la mission et les valeurs du groupe Ulterïa soient remises en question à long terme. Donc ça a été très concret.
Quel a été votre déclic ? Refuser un chèque de plusieurs millions d’euros ne se fait pas sur un coup de tête.
Alexis Nollet : On n’a pas intellectualisé la séquence. Notre décision a été plutôt liée à nos idéaux adolescents – on a travaillé tous les deux dans des ONGs, notamment dans des bidonvilles –, nos débuts professionnels ont été pour tous les deux très axés sur la création de bénéfices et les remboursements d’emprunts. À ce moment, c’est plus les tripes qui ont parlé car l’intellect pousse à prendre l’argent et à mettre sa famille à l’abri. Donc on a demandé à notre avocat de l’aide pour changer nos statuts afin de sanctuariser notre capital et empêcher l’entreprise d’être vendue à n’importe qui. Plus précisément, je n’ai pas de souci avec la notion de transmission ou de vente. Mais cela ne peut et ne doit pas se faire dans l’unique but de maximiser des profits et au seul bénéfice des actionnaires. Les parties prenantes et la personne morale doivent également être respectés. Après avoir tâtonné, on a trouvé le bon véhicule : le fonds de dotation.
On a donné 10% du capital à un fonds de dotation qui est une personne morale à gouvernance désintéressée, un peu comme une association ou une fondation. Il a une vocation philanthropique et possède un droit de véto à notre comité stratégique. Ce comité est garant du respect par les actionnaires des valeurs et de la mission d’Ulterïa. D’ailleurs, l’autre droit de véto est détenu par un fonds d’investissement qui est un des rares en Europe (une vingtaine tout au plus) engagés autant que possible dans la transition. A terme, le fonds de dotation devrait posséder 100% du capital.
Cela dit j’aime bien le modèle des trois tiers : un tiers pour les collaborateurs·trices qui font la valeur de l’entreprise, un tiers pour des fonds d’investissements car il n’y a pas de projet industriel sans structure qui thésaurise un minimum et un tiers pour le fonds de dotation. Ces diverses options n’empêchent pas par exemple les créateurs de s’octroyer un petit bonus à la sortie.
Je crois de moins en moins à un modèle unique. Il faut créer des modèles sur mesure selon les territoires, les missions, les valeurs des entreprises sur le long terme. De nombreuses entreprises de belle taille ont franchi le cap récemment : Léa Nature, CETIH (menuiseries), Naos, Bureau Vallée…
Claude Gruffat : Le fonds de dotation actionnaire est-il le modèle privilégié ?
Alexis Nollet : Non, le fonds de dotation est adapté aux personnes qui, comme moi, viennent de l’entreprise classique et qui ont besoin de financements importants. Il y a d’autres modèles comme les SCOP, les SCIC, les coopératives, les entreprises de l’ESS…
Claude Gruffat : En effet les modèles de type SCOP sont très liés aux personnes qui les portent, avec un risque pour l’entreprise en cas de désaccords entre partenaires. Ce que tu dis rappelle qu’on peut pérenniser une entreprise sur un territoire, assumer les valeurs de la transition écologique, assumer les valeurs d’une gouvernance partagée avec les salariés, etc. et en même temps faire entrer des financiers indispensables au développement. La démarche « fondation actionnaire » ouvre les portes à du développement, à de la valeur et à la transition écologique, plutôt que de les fermer.

Existe-t-il des exemples de transmission réussies et à fort impact écologique ?
Alexis Nollet : Je vous invite à regarder le Groupement De Facto qui fédère des entreprises pionnières (Bureau Vallée, Archimbaud, Bio Perennis, Vitamine T…) et des expert·e·s européen·ne·s afin de promouvoir le développement des Fondations actionnaires en France. On a de vrais entrepreneurs qui cherchent une solution pour pérenniser la raison d’être de leur entreprise et qui sont devenu·e·s allergiques à la création de richesse comme unique horizon.
Bio Perennis est aussi un bon exemple, c’est une fondation actionnaire (techniquement fonds de dotation actionnaire) multi-actionnaires d’entreprises de la bio. Nous avons donné une action d’Ulterïa à Bio Perennis. Ce qui donne droit à un représentant de Bio Perennis de siéger dans notre organe de gouvernance et d’objecter les décisions qui ne respecteraient pas les valeurs de la bio. Le but étant de permettre aux entreprises de rester fidèles à la mission et aux valeurs historiques, confrontées à la problématique du temps long. Claude était à l’origine de cette initiative.
Claude Gruffat : Quand les PME de la bio se faisaient massivement racheter par des vautours de l’industrie, qui déconstruisaient des filières patiemment construites sur des décennies, ça a choqué le milieu de la bio et donné le coup d’envoi de ces réflexions. C’est ce qui a donné le mouvement des fondations d’actionnaires dont on parle aujourd’hui et de ce collectif qui nous questionne en permanence. C’est un cheminement personnel très difficile. Il y a une théorie que je trouve intéressante, celle du capitalisme conscient (de John Mackey, créateur de Whole Food Market), qui s’intéresse à ces problématiques-là.
Avez-vous des exemples de transmissions désastreuses faute de limites dans le cadre actuel ?
Claude Gruffat : Prenons l’entreprise Celnat en France, des pionniers de la bio. C’était le premier transformateur de céréales en France en termes d’outil, de savoir-faire, de qualité de produits. Les propriétaires au moment de la retraite ont vendu au groupe Ebro, un géant espagnol de l’agro-industrie qui a mis la main sur un outil industriel et des savoir-faire de très haut de gamme mais qui du coup étaient perdus pour le milieu de la bio en France et les territoires. Aujourd’hui ils sont approvisionnés par des filières venant de l’autre bout de la planète. Une catastrophe en amont car ça a déconstruit des filières françaises. C’est également une perte pour les consommateurs·trices qui ont perdu une marque référence en terme d’engagement.
Le système actuel comporte-t-il des freins à ce type de démarche ou est-ce avant tout une question de volonté humaine ?
Alexis Nollet : La question n’est pas tant réglementaire que philosophique. Les solutions existent mais il manque encore la volonté de massifier ce type d’entrepreneuriat. C’est un cheminement personnel très complexe. Quand on est entrepreneur·euse on est entouré·e de personnes très riches qui ne cherchent pas forcément à aligner leur activité économique avec des valeurs et une vision du sens de la vie. On est bizarrement regardés dans le milieu économique.
Claude Gruffat : En France, ces démarches sont émergentes. En Europe du Nord ce n’est pas la même chose. 54 % de la capitalisation boursière du Danemark est détenue par des fondations actionnaires. On doit être à 40 ou 50% en Allemagne. C’est le cas de certaines des plus grosses entreprises allemandes, même si ce n’est pas, pour d’autres raisons, une preuve de réussite au niveau social. Mais leurs entreprises ne sont pas rachetées alors qu’en France, les entreprises créatrices de richesses changent de propriétaires en moyenne tous les 7 ans avec des ponctions par les actionnaires qui les affaiblissent et les obligent à recréer de la valeur en permanence au lieu de se renforcer et d’assurer leur développement. Il faut consulter les études de l’entreprise de conseil Prophil qui travaille là-dessus.
En 2019, quand on travaillait sur ces questions, lors de la préparation de la loi PACTE avec les entreprises citées par Alexis plus tôt, les équipes de Bercy n’y croyaient pas et ne comprenaient pas la démarche.
Alexis Nollet : Je connais beaucoup de patron·ne. Par contre je n’en connais aucun·e qui soit une mauvaise personne. L’argent est rarement le moteur principal des entrepreneurs·euses, c’est un état d’esprit. Mais la vraie question est peut-être : l’entreprise n’est-elle pas un bien commun ? Elle crée de la valeur sociale et environnementale en plus de sa fonction économique. Mais le cadre est à inventer car la liberté individuelle est essentielle. Un bon entrepreneur doit-il toujours être celui capable de créer le maximum de richesses le plus vite possible ? Il y a toutes sortes de talents qui mériteraient d’être valorisés, pas que celui-ci.